Mon train pour Deauville est bloqué en gare d’Evreux pour une durée indéterminée ; des informations sont diffusées au compte-goutte par la SNCF à travers une sono déficiente ; mes cours de la journée en Normandie sont remis en question ; gigantesque panne du RER A la semaine dernière, violences à Air France et sempiternels blocages corporatistes ; sans parler de la crasse des rues parisiennes : de retour depuis peu du Japon, sentiment diffus d’être revenu dans un pays du Tiers-monde.
.
.
Expérience pleine d’enseignements - d’autant que j’ai eu la chance de commencer mon voyage avec une amie japonaise - la découverte du Japon (de Tokyo à Nagasaki, en passant par Kyoto, Nara, Koyasan, Hiroshima et Kurashiki) mériterait sans doute un très long article, voire un récit de voyage. Somptuosité des temples, grâce et délicatesse des jardins, des femmes, politesse, respect, gentillesse des japonais, beauté sublime des paysages, mariage de la modernité et de la tradition, ou encore saveur extraordinaire de la cuisine : tout cela est bien réel et source de découvertes et de joies, de même que mes quelques jours de pèlerinage sur le Kumano kodo, ce chemin classé au Patrimoine mondial de l'humanité dans la province du Kansaï. Mais dans le cadre restreint de cet article, il s’agit plutôt de se focaliser sur quelques points significatifs qui ont aiguisé ma sensibilité et ma réflexion lors de ce voyage.
.
Plusieurs choses frappent immédiatement le voyageur européen : la propreté irréprochable des rues, des lieux publics, des gares, des lieux d’aisance (et leur nombre important) ; l’organisation sans faille et la ponctualité, des entreprises, des trains, bus, etc. ; l’extraordinaire discipline, et l’absence de l’idée même d’incivilité – des files d’attente se forment spontanément à tout propos, sans mauvaise humeur et sans qu’il ne vienne à l’idée de personne d’essayer de resquiller ; l’absence corrélative de violence ou de stress dans les rapports humains, et le sentiment d’être toujours pris en considération ; tout un ensemble de facteurs donc qui rendent le voyage au Japon étonnamment simple et reposant, et qui vont à l’encontre d’un certain nombre de nos représentations.
.
.
Evidemment, un esprit latin comme le mien ne peut s’empêcher d’avoir un œil goguenard devant ces piétons qui attendent sagement le signal qui leur permettra de traverser une rue déserte, où il n’y avait de toute façon aucun véhicule à l’horizon pouvant représenter un danger quelconque. On connaît aussi les clichés sur la discipline supposée déshumanisée de fourmis et le rythme de travail implacable des japonais. Ces représentations ont bien une part de vérité, même si les japonais ont un sens de la fête assez développé, qu’ils manifestent assez facilement leur bonne humeur et qu’ils accordent aussi beaucoup d’importance à la vie de famille. Il est vrai que cette organisation rigoureuse et ce confort ont un coût, et le nombre de gens qui somnolent dans les transports en commun est significatif à cet égard. De même, dans ce pays où l’agressivité semble incongrue, et même bannie (il ne faut pas "perdre la face"), la violence trouve sans doute à s’exprimer d’une autre manière : peut-être se retourne-t-elle contre soi-même - les chiffres indiquant un taux très élevé de suicides.
.
Les critiques ne sont donc pas totalement infondées, et, de fait, le voyageur peut osciller entre admiration et sentiment de malaise envers ce qui apparaît parfois comme un « meilleur des mondes », avec ce que cette notion véhicule depuis le roman d’Huxley. L’atmosphère envoûtante d'inquiétante étrangeté des romans d’Haruki Murakami, où le lecteur a affaire à des milieux plutôt aseptisés et à des sectes parfois étranges doit beaucoup à cet arrière-plan, à ce terreau singulier qui féconde sa littérature. Mais, pour saisir ce qui fait la singularité de ce peuple, il convient de dépasser cette vision trop courte d’une civilisation japonaise un peu déshumanisée et lobotomisée. Pour mieux comprendre certaines des caractéristiques - souvent très positives - évoquées plus haut, il faut plutôt prendre en compte le cocktail aléatoire de déterminations géologiques, géographiques, culturelles, religieuses et historiques au principe de cette civilisation. C'est en se situant sur un plan géo-philosophique que l'on peut adopter une position de retrait plus féconde permettant de s’élever depuis des préjugés communs et idées toutes faites véhiculées par les médias à une vision plus claire.
.
.
L’approche géo-philosophique (conceptualisée par le philosophe Gilles Deleuze) établit une sorte de parallélisme entre, d’une part, les mouvements relatifs - géologiques, géographique, météorologiques, écologiques et sociologiques – et, d’autre part, les mouvements absolus – ceux de la pensée. Cela permet de rendre compte à un premier niveau de la forme de syncrétisme caractérisant le Japon. On le sait en effet, des plaques tectoniques immenses s’y rencontrent, de même que des courants et des vents contraires (source de typhons très nombreux), et une végétation luxuriante, multiple et diversifiée. Disons en passant que les catastrophes naturelles – tsunamis, typhons, tremblements de terre – expliquent sans doute en partie l’extraordinaire sentiment de solidarité organique qui émane de la société japonaise pour un observateur occidental : tout se passe en effet comme si, ce type de catastrophes pouvant se produire à tout moment, chacun avait intégré la nécessité de ne pas infliger à la communauté d’autres souffrances inutiles et de travailler au bien-être commun.
.
A un second niveau, la détermination géo-philosophique insulaire rend compte des nombreuses influences qui, historiquement, participent de l’identité japonaise. De ce point de vue, le Japon fonctionne comme une systole, avec ses mouvements d’ouverture, dans un premier temps : ouverture au bouddhisme, à l’art coréen, au christianisme, à l’Occident et sa modernité, etc. Dans un style qui lui est propre, il s’est ainsi remarquablement approprié ces éléments constitutifs. Pour preuve l’assimilation et la transformation très intéressante – comme Zen - du bouddhisme indien (lequel, comme Chan, a d’abord transité par la Chine) permet de mieux comprendre ce qu’il peut y avoir de touchant dans cette société (et sur lequel je reviens un peu plus bas).
Mais, dans un second temps, la systole comprend un mouvement de fermeture, la solidarité organique pouvant alors prendre l’aspect d’une opposition ; de fait, un groupe humain se pose bien souvent en s’opposant à ceux qui n’en font pas partie. Pour ce qui concerne le Japon, le sentiment de solidarité organique repose aussi en partie sur une mythologie propre, avec des interprétations toujours susceptibles de durcir des distinctions classiques (sacré/profane, purs/impurs ; autochtones/étrangers, etc.) : le Kojiki, ou « Chronique des faits anciens », le plus ancien texte japonais - avec le Nihon Shoki qui inspire toutes les pratiques shintoïstes -, se veut un récit des origines sacrées, de l’Empereur, descendant direct des dieux, ainsi que de la formation des îles japonaises. Origines sacrées du Japon, de l’Empereur, et de son peuple : on sait ce que ce type de représentations a pu entraîner dans l’Histoire. Sans même évoquer les extrémités liées au sentiment de supériorité, cela se traduit aujourd'hui concrètement dans la société japonaise par une certaine crainte de l’autre, de la mixité, et surtout de la dissolution de l’identité.
.
Rien de bien original, par rapport à d’autres sociétés, dans cette posture identitaire, avec une droite extrême qui met opportunément depuis quelques années l’accent sur le Shinto des origines. Plus largement, l’histoire du Japon est ainsi jalonnée de périodes de fermeture - contre le bouddhisme, le christianisme, les influences étrangères, occidentales, coréennes, chinoises - au nom de ce Shinto originel. Or, cette vision identitaire est éminemment contestable : en effet, en tant qu’ensemble de pratiques animistes disparates, le Shinto doit bien plutôt être compris comme une pré-religion, un peu comme le néant qui précède le Big-bang. Dès lors, les opérations d’épuration qui se sont régulièrement produites en son nom reposent surtout sur des reconstructions a posteriori. Incompréhension de son essence, malentendu à la source d’une fonctionnarisation des prêtres et de leur instrumentalisation par le politique – c’est tout un ensemble de conséquences guerrières parfois désastreuses qui se sont précipitées durant les ères Meiji et Edo, et évidemment au 20ème siècle.
A l’inverse de cette fermeture identitaire susceptible de postures sclérosantes, voire dangereuses, un grand nombre de spécialistes du Japon (historiens, sociologues, spécialistes des religions, anthropologues) s’accordent sur l’idée d’une sorte de magnétisme du vide Shinto, lequel attire et englobe le bouddhisme, le Tao, l’Occident, etc. Eminence du vide (en Chine comme au Japon), c’est peut-être bien cela qui fait la grandeur, « l’essence » de la culture japonaise. Le grand écrivain – Ô combien japonais - Mishima disait que le Japon était un creuset vide, ou il n’y avait rien d’original : seulement ce vide qui aspire toute chose et les recrache en les transformant.
.
.
Une chose, indissociable du Zen, m’a particulièrement touché lors de ce voyage : la façon dont la tâche la plus humble (balayer, par exemple) est accomplie avec grâce, de façon scrupuleuse, en s’efforçant de donner le meilleur de soi-même. Jamais ne prévaut l’image de quelqu’un qui ferait juste le minimum, avec mauvaise humeur devant une tâche considérée comme indigne, comme nous pouvons souvent en faire l’amère expérience dans nos contrées. Corrélativement, prévaut le sentiment largement partagé que tout travail est digne d’être infiniment respecté, ce qui confère à chacun une forme de sécurité, un sentiment de reconnaissance, et constitue une source d’estime de soi. Il est vrai que l’on retrouve cette disposition d’esprit ailleurs, sous l'égide de différents Maîtres spirituels : le poète soufi Khalil Gibran ne parle de rien d’autre dans son poème « Le travail » (Le prophète) quand il évoque la nécessité de lier le travail à l’amour afin que celui-ci ait vraiment un sens. C’est aussi cette disposition qui est à la source du karma yoga indien – cette aptitude à considérer toute tâche de façon spirituelle, en étant intégralement présent dans ce que nous faisons, sans se focaliser sur une quelconque rétribution. Cette dimension spirituelle imprègne (encore un peu) la mentalité indienne sous l’influence de nombreux ashrams, et elle fut magnifiquement incarnée au 20ème siècle par Gandhi et sa façon de « s’investir » dans les tâches les plus humbles.
Mais ce qui fait l’originalité du Japon en la matière, c’est évidemment la façon dont ces dispositions se concilient avec les exigences de productivité d’une société hyper moderne dans la compétition mondiale. De fait, tout en étant en pointe dans bien des domaines, les japonais font un effort particulièrement important pour conserver leur Tradition, et cela inclut un certain nombre de métiers qui ont aujourd’hui disparu dans d’autres régions du monde.
.
.
C’est ici qu’intervient la dernière détermination (mais pas la moindre) que je souhaitais évoquer : celle qui touche à l’histoire moderne. Suite aux événements de la 2nde Guerre Mondiale, cela fait soixante-dix ans que le Japon est sous protection américaine et, par là-même, « dispensé » de tout effort militaire. Dès lors, les capacités japonaises de travail, d’entreprise, d'organisation et d'innovation se sont évidemment réorientées : il en résulte une économie que l’on sait très performante (même si, paraît-il, les choses vont un peu moins bien ces dernières années), avec la culture de la consommation qui l’accompagne. Il ne s’agit cependant pas de caricaturer cette dernière dans la mesure où, si elle n’est pas sans certains excès, il s’agit bien plutôt de développer dans toutes ses implications le potentiel du Zen comme véritable culture du bien-être. Ce qui implique de façon indissociable un intérêt pour toutes les productions culturelles, les valeurs de respect de l’environnement, le souci de la communauté et l’attention à l’autre, toutes dispositions qui se traduisent de manière très concrète dans le quotidien et qui sont au principe de la qualité de vie japonaise. Parallèlement, fort de l’expérience atomique, les japonais se positionnent comme des phares en matière de paix dans le monde, avec nombre d’initiatives culturelles, pédagogiques et politiques.
.
Cette atmosphère privilégiée peut parfois donner au voyageur le sentiment d’un décalage. Il y aurait comme un hiatus entre ce souci permanent de bien-être et la marche tragique du monde. Shinzo Abe, le 1er Ministre japonais, sans doute encouragé par d’autres puissances internationales, a pris la mesure de ce décalage. Dès lors, il cherche à réformer la Constitution de telle sorte que le Japon puisse se réarmer afin de participer éventuellement à diverses opérations militaires. Il considère non sans une certaine lucidité que, dans le contexte international actuel, le Japon ne peut se contenter de jouir de sa croissance, sans se préoccuper de l’état du monde. Mais, dans ce pays peu habitué à la révolte, ces positions provoquent actuellement un fort mouvement de protestation, notamment au sein de la jeunesse. Il est vrai que ce qui se passe à Hiroshima et Nagasaki est à la fois édifiant et émouvant. L'idée qu'un pays puissant, prospère, technologiquement en pointe soit en même temps un exemple de pacifisme est séduisante. Pourtant, si je devais me faire l’avocat du diable, je dirais qu’Abe, en bon hégélien (qui s’ignore), considère peut-être qu’un peuple uniquement tourné vers le bien-être risque fort de s’amollir.
.
.
Il ne s'agit pas d'encenser ici le modèle japonais, ni, a contrario, de critiquer le modèle français d'intégration. De toute façon, crasse ou non, Paris reste Paris, comme le savent les japonais eux-mêmes, quand on se promène par une belle journée printanière du côté de Saint Germain des Prés. Simplement, comme c'est souvent le cas, la rencontre de l'autre, l'épreuve de l'étranger, fait ressortir la singularité de certaines de nos caractéristiques propres ; et, en ce sens, elle est évidemment féconde. Quoi qu’il en soit, elle amène à réfléchir sur ce qui fait à la fois la grandeur et la difficulté de la France dans son souci historique d'universalité. Mais cet article est déjà trop long, et cette analyse comparée devrait faire l'objet d'un prochain article.
.
A mon sens le Japon est source d'enseignement mais n’est pas, contrairement à l’Inde, un pays qui éveille les passions. Cependant, "fécondité du vide" sans doute, quelques semaines après mon retour, je réalise que l'expérience du pays du soleil levant a plus d'impact que je ne le pensais initialement, et qu'elle est en train de s'inscrire de façon subtile, mais profonde, en moi.
/image%2F0669930%2F20220202%2Fob_de12fe_img-20220127-183309-531.jpg)



/image%2F0669930%2F20220202%2Fob_a246df_img-20220127-183309-531.jpg)
/image%2F0669930%2F20210602%2Fob_a0ab91_kundalini.jpg)
/image%2F0669930%2F20210517%2Fob_63267d_chemin-de-saint-jacques-de-compostelle.jpg)
/image%2F0669930%2F20201106%2Fob_890601_ouest-americain-4556656.jpg)
/image%2F0669930%2F20201005%2Fob_bf3b09_source-vive-cadre-ws11839704.jpg)


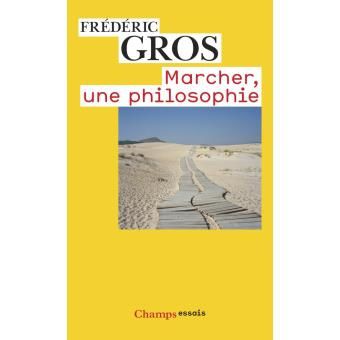



/image%2F0669930%2F20140924%2Fob_12931f_p1020094.JPG)



